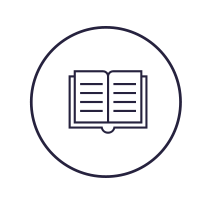L’assemblée générale du CNB prend position sur les différentes thématiques du questionnaire de la mission relative à la déjudiciarisation (civile, pénale et aide juridictionnelle) tout en rappelant son attachement à la préservation de l’accès au juge et de l’accès au droit des justiciables.
En matière civile
Le garde des Sceaux a annoncé, le 20 novembre 2024, trois missions d’urgence pour juger dans des délais raisonnables et mieux exécuter les peines. La première de ces missions, relative à déjudiciarisation, tend à « recentrer la justice sur son rôle ».
Le Conseil national des barreaux s’est prononcé, le 17 janvier 2025, sur les orientations générales que la mission devait donner à ses travaux en rappelant que la déjudiciarisation ne saurait ne saurait être dictée par des seules considérations financières et que le Comité des États généraux de la justice soulignait, dans ses conclusions, que la déjudiciarisation « a aujourd’hui atteint ses limites ».
Dans la perspective de l’audition prochaine du Conseil national des barreaux, la mission a adressé un document de réflexion, qui se présente sous la forme d’un questionnaire invitant les acteurs concernés à se prononcer sur les pistes de déjudiciarisation envisagées “dans les rapports déposés au cours des deux dernières décennies mais également sur les pistes nouvelles explorées par le groupe de travail à la suite de suggestions qui lui sont parvenues”, notamment pour ce qui concerne les thématiques civiles (droit de la famille, des personnes et du patrimoine, droit de la commande publique, procédure d’hospitalisation sans consentement, procédure civile et MARD etc.)
Tout en formulant des propositions concrètes de nature à améliorer la situation des justiciables dans ces différents domaines, les rapporteurs de la commission des Textes réitèrent les précédentes critiques formulées sur cette mission et dénoncent le fait que l'avocat et l’acte d’avocat sont systématiquement exclus des premières solutions envisagées pour améliorer les délais de jugement et rendre plus efficiente l’action de la justice.
En matière pénale
Le document de réflexion concernant la déjudiciarisation pénale évoque la possibilité de de remplacer l’ensemble disparate des alternatives aux poursuites, par une mesure unique, que les Etats généraux de la justice désignent sous le nom de transaction pénale et qui serait à la main du parquet. Celui-ci en définirait les modalités. Au-delà de l’intérêt en termes de clarification, le juge correctionnel se trouverait déchargé de l’homologation des compositions pénales. Pour équilibrer la perte de cette garantie, l’accès au dossier serait possible pour la défense et le mis en cause pourrait toujours revenir sur l’accord donné pour demander à ce que l’affaire soit soumise au tribunal.
Le CNB a exprimé son opposition à toute disparition de l’homologation de la mesure par un juge du siège, qui représenterait un recul notable de l’accès à juge indépendant et plus généralement de l’accès au droit et une disparition du contrôle de légalité de la mesure proposée.
Le document de réflexion évoque également une extension de l’amende forfaitaire délictuelle. Sur ce point, le CNB a rappelé sa position adoptée en 2022 selon laquelle l’amende forfaitaire délictuelle est une condamnation correctionnelle sans débat contradictoire, sans juge, sans avocat. Son extension significative n’est pas acceptable et constituerait incontestablement un recul des droits et garanties des justiciables, en particulier des plus précaires d’entre eux.
S’agissant de la possibilité de rendre obligatoire l’assistance par un avocat pour déposer une plainte avec constitution de partie civile, le CNB comprend l’intérêt d’une telle réforme dans la mesure où la technicité de l’acte requiert une assistance par un avocat, seul à même de qualifier les faits.
En outre, le CNB constate que le principe d’accès à la justice n’est pas entravé du fait de la possibilité de déposer une plainte et que l’aide juridictionnelle est de droit pour la plupart des infractions les plus graves en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1990.
De la même manière, le CNB n’est pas opposé à la création d’un juge unique de l’indemnisation pour les victimes.
Enfin le CNB s’est prononcé contre le recul annoncé du recours à juge indépendant.
Le CNB réaffirme ainsi son attachement à une justice accessible à tous, sans discrimination ni obstacle financier.
En matière d’aide juridictionnelle
Trois missions thématiques ont été lancées par l’ancien GDS et poursuivies par le nouveau. L’une d’elle porte sur la déjudiciarisation. Dans le cadre des échanges et questions posées par cette mission, deux concernent l’aide juridictionnelle, ci-après reproduites :
- Envisager de confier à l’administration fiscale l’examen et les décisions en matière d’aide juridictionnelle, les BAJ/juridictions n’en connaissant qu’en cas de refus ou de retrait ;
- Explorer les mesures de simplification envisageable en matière d’AJ : suppression de l’AJ partielle, limitation de contrôle du caractère sérieux du recours à la demande d’AJ en appel
Le CNB, rejetant ces mesures, alerte sur les enjeux, en particulier sur ce qu’auraient à y perdre les justiciables.
D’une part, confier à l’administration fiscale l’examen et les décisions en matière d’aide juridictionnelle n’aurait pas de sens et comporterait de nombreux risques pour le fonctionnement des juridictions, pour les justiciables et pour la bonne administration de la justice.
D’autre part, la suppression de l’aide juridictionnelle partielle, en privant une partie des justiciables de l’accès à un juge, constituerait une entrave à l’accès au droit et à la justice. Ceci serait accentué par l’instauration d’un contrôle du caractère sérieux du recours, au stade de la demande d’aide juridictionnelle, en appel, qui reviendrait à mettre en place un filtre, au niveau de la demande d’aide juridictionnelle.
La profession, marquant son opposition à la mise en œuvre de telles mesures, demeure attentive à ce qu’aucune entrave à l’accès au droit et à la justice ne puisse être instaurée de manière directe ou indirecte.